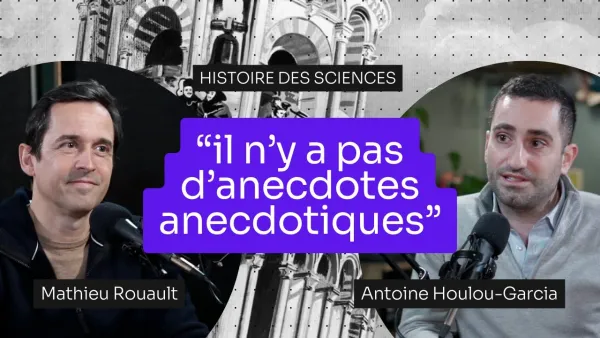Plan S, creatives commons, nouvelles plateformes... : la science ouverte sous le regard des éditeurs scientifiques publics
Fin septembre dernier, quelques jours seulement après le Congrès de l'ADBU, se tenaient à Nantes les 9e journées du réseau Médici, qui réunit chaque année les acteurs de l'édition scientifique publique. Au programme : ateliers, débats et discussions autour de l'open access.
A moins d’un an de la mise en œuvre du Plan S, la question de la science ouverte et de ses modalités concrètes de mise en œuvre n’en finissent pas de susciter des débats dans les différentes communautés professionnelles de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ce sujet était au centre des échanges des 9e Journées du Réseau Médici. Quelle doit être la place des éditeurs scientifiques publics dans le grand concert de l'open access ?
Pour commencer à répondre à cette question, Jean-François Lutz, responsable de la bibliothèque numérique à l’Université de Lorraine, a rappelé, au cours d’une présentation liminaire qui a filé la métaphore musicale, que la musique du libre accès a d’abord été interprétée au début des années 90 par des solistes : individualités et petites communautés souvent issues de la culture du logiciel libre. Plus tard seulement, dans les années 2000, sont venues les institutions. Et si l’orchestre semble aujourd’hui au complet - le libre accès paraît faire consensus même chez les éditeurs commerciaux - « il manque un chef d’orchestre ou, à tout le moins, une partition commune » explique Jean-François Lutz.
C’est que trois stratégies différentes se sont confrontées ces dernières années. La première est celle de Janet Finch a proposé au Royaume-Uni dans son rapport de 2012. Son idée : que les pouvoirs publics payent davantage les frais de publication d’articles (Article Processing Charges ou APC) pour que les articles des chercheurs du Royaume-Uni soient diffusés en libre accès dans des revues ouvertes. Onéreuse et peu efficace, l’approche a fait long feu. L’autre stratégie est venue en 2015 d’Allemagne, plus exactement de la Max Planck GesellSchaft : négocier conjointement abonnements et APC. C’est l’Initiative Open Acess 2020, qui prône la mise en place d’accords transformants pour tous les pays, toutes les institutions, en recueillant des engagements auprès de consortium locaux. Pour ambitieuse qu’elle soit, cette stratégie a elle aussi été critiquée : elle ne s’adresserait qu’aux gros éditeurs de sciences dures, laissant de coté les petits éditeurs plus modestes. La troisième voie est celle de la bibliodiversité : au lieu d’une voie unique, monolithique, l’open access doit prévoir la possibilité d’un paiement ni par les auteurs, ni par les lecteurs, et encourager innovation de nouveaux modèles. C’est le sens de l’article 8 de l’Appel de Jussieu, lancé en 2017.
Au-delà de l'aide annoncée par le Gouvernement de quelques 2,6 millions d’euros aux éditeurs pour encourager ces derniers à basculer dans la science ouverte, l’absence de « chef d’orchestre » et de vision partagée a-t-elle compliqué l’appropriation par les éditeurs scientifiques publics des nouvelles règles du jeu qu'impose progressivement la science ouverte ? Elle n’aura certainement pas, en tous cas, facilité ce travail, rendu difficile par l’épineuse question du modèle économique et, peut-être aussi, par certains préjugés sur le libre accès.
Éditer dans un contexte de science ouverte
Lever ces préjugés et malentendus, c’est justement ce à quoi s’est récemment attachée la cellule Open Access du SCD d’Aix-Marseille Université, dont est membre Isabelle Gras, conservatrice de bibliothèque. Elle a mis en place une collaboration avec les presses universitaires locales (PUP et PUAM) pour faire avancer l’idée que « les problématiques de science ouverte sont des sujets qui s’inscrivent dans le prolongement des missions éditoriales des éditeurs scientifiques ». L’auteur d’un article dispose de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre : seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’un contrat avec un éditeur, selon les termes mêmes de l’art 30 de la loi pour une République numérique, transposés dans l’article 533-4 du Code de la recherche. L’enjeu de cette collaboration a été de faire en sorte que la version manuscrite d’une publication scientifique financée au moins pour moitié par des fonds publics puisse être déposée avec un embargo de douze mois pour les sciences humaines et de six mois pour les sciences techniques et médicales. Ce dispositif ouvre un droit au chercheur à déposer et fixe pour l’éditeur un cadre légal favorable à l’open access tout en le rendant acteur de son déploiement : l'éditeur peut proposer des durées d’embargo plus courtes. L’objectif de cette collaboration a été de faciliter la visibilité du processus de production éditoriale en favorisant le dépôt par les auteurs des PUAM dans l’archive ouverte. Comme l'explique Isabelle Gras, « il n'est pas toutjours simple pour un chercheur de savoir à partir de quel moment déposer dans une archive ouverte. Il faut simplifier les mécanismes éditoriaux ».
Mécanismes éditoriaux qui peuvent s’avérer parfois complexes dans un contexte de science ouverte. Prenez l’exemple des licences creatives commons. Pendant longtemps, le statut juridique de ces licences en droit français a posé question. Elle sont devenues aujourd'hui des standards incontournables : près de 1,4 milliard d’œuvres sont placées sous licence creative commons. « A ceux qui en doutent encore, j’ai l’habitude de rappeler que le site du Ministère de la Culture est sous licence CC-by ! » s’amuse Lionel Maurel, directeur-adjoint scientifique IST à l'InSHS, au CNRS.
Licences CC
Inspirées des logiciels libres et apparues au début des années 90, très souples d’utilisation - l’auteur choisit les restrictions qu’il souhaite apporter à l’utilisation de son œuvre en combinant différentes clauses pour former six contrats plus ou moins ouverts - ces licences peuvent même, depuis la version 4, s’appliquer aux données. Lionel Maurel observe que le déploiement de ces licences redonne vie aux théories du sociologue américain Robert King Merton, concepteur du communalisme scientifique, pour qui les chercheurs ne sont pas les propriétaires individuels de la science qu’ils produisent. Avant les années 2000, cette conception restait lettre morte, faute d’outils pour la faire vivre. Les choses changent avec l'arrivée des licences creatives commons : quand PLOS se lance dans les années 2000, tous les articles sont placés par défaut sous licence CC-BY. Certes, en France, 10 % seulement des contenus de HAL sont actuellement placés sous licence creative commons et, parmi ces 10 %, seule la moitié sont en CC-BY. Lionel Maurel reste optimiste : « si l’on se souvient que ce sont les auteurs eux-mêmes qui font la démarche volontaire de placer leurs écrits sous ces licences, ce n’est pas si mal ! » Pas étonnant, dès lors, que le Plan S leur consacre un point spécifique.
Mais, à y regarder de près, les principes sur lesquels reposent les licences creatives commons coïncident-ils avec les pratiques de certains acteurs de l’open access ? Rien n’est moins sûr, selon Lionel Maurel. Les fondateurs de l’open access faisaient un lien entre le libre accès et le « libre », tout court, comme en témoigne la déclaration de Budapest. Dans leur esprit, la seule chose que le copyright doive protéger, c’est le droit moral de l’auteur, rien d’autre. Or, explique Lionel Maurel, « ce lien entre libre accès et libre réutilisation s’est ensuite perdu ; on a cessé progressivement de parler de libre accès pour parler d’accès ouvert. » Par définition, ce qui est ouvert peut se refermer. C’est là un hiatus inacceptable pour les données scientifiques, par exemple : comment concevoir des données ouvertes qui ne soient pas en même temps accessibles, utilisables, manipulables ? Lionel Maurel enfonce le clou : « seule une licence creative commons donne une garantie effective de liberté des productions scientifiques ».

Un cas récent a pourtant permis d’en douter. En mai 2019, la plateforme en open access Knowledge Unlatched, fondé sur un nouveau modèle de souscription à destination des bibliothèques universitaires, annonçait un changement de son modèle en lançant Open Research Library. Le but de cet outil : recenser tous les livres publiés en creative commons et, tout autour, disposer une gamme de services dont certains payants... L’exemple doit-il conduire les éditeurs scientifiques à se méfier de ces licences ? « Non », répond Lionel Maurel, « mais on ne fait pas de science ouverte sans construire d’infrastructures solides, pérennes et non capturantes. »
Lionel Maurel le rappelle : le Plan S affirme que l’auteur doit garder tout ses droits, il n’existe plus d’exclusivité possible pour l'éditeur. La seule chose que peut vendre l’éditeur, c’est son travail. La place de l’éditeur change « mais on n’anticipe pas très bien les conséquences du Plan S sur l’édition globale ».
Pour Corinne Tiry-Ono, cheffe du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère au ministère de la Culture, cette anticipation est d'autant plus nécessaire que la science ouverte change les pratiques de toutes les disciplines, y compris en architecture. Les chercheurs de cette discipline, traditionnellement attachés au format papier, modifient petit à petit leurs pratiques. Le cas des Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, en accès libre sur Open Edition, en est un exemple : sa numérisation a permis une meilleure délégation du pilotage scientifique et éditorial.
Pour Laurent Devisme, professeur à l'Ensa Nantes, qui animait la table-ronde intitulée « Recherche, monde professionnel, commercialisation et science ouverte : une nouvelle (ad)équation ? » ces questionnements et hésitations se font aussi jour aussi dans certaines revues professionnelles (juridiques, STAPS, etc.). Pour y remédier, Laurent Devisme considère qu'une partie de la solution consiste pour ces revues à "mettre les coulisses sur la scène". Comprendre : qu'elles partagent leurs pratiques, mettent en commun leurs réflexions sur ce que la science ouverte change pour elles.
Plateformisation de l’édition scientifique
Dernier grand temps de ces journées, une table-ronde sur la notion de plateformisation de l’édition scientifique en forme de retour d'expériences concernant les ouvrages, domaines de prédilection des éditeurs scientifiques publics. Marie Pellen, directrice d’Open Edition, y a dressé un premier bilan d'Open Edition Books, plateforme née en 2013 et dédiée aux livres. Pourquoi ce nouveau service ? D’abord, explique Marie Pellen, « plusieurs éditeurs de revues sur Journals - à l’époque Revues.org - nous faisaient remonter des demandes de publication de livres, demandes que nous devions décliner, car cela n’était pas la fonction de Journals ». Ensuite, il s’agissait d’aider les éditeurs à se positionner en termes de diffusion numérique. Enfin, « nous voulions encourager la diffusion d’ouvrages en accès ouvert tout en prenant en considération les enjeux économiques ». Open Edition Books démarre avec une centaine d’ouvrages et treize éditeurs de confiance. Ils sont aujourd’hui une centaine. « Nous répondions à une demande naissante », raconte la directrice d'Open Edition, qui ajoute : « les premières années, il n’y a pas eu de bascule massive mais, fin 2015, les demandes se sont multipliées ». Grâce à un financement Equipex, Open Edition Books passe à la vitesse ssupérieure : 9 000 ouvrages sont numérisés, structurés puis chargés, sans aucun frais pour l’éditeur mais à condition que celui-ci propose 50 % des ouvrages en accès ouvert Premium. Dans ce système, 66 % des revenus reviennent à éditeur, 34 % à Open Edition. Sur les 8 100 ouvrages actuellement en ligne de la plate-forme, 72 % sont diffusés en accès Freemium.
L’une des raisons du succès d’Open Edition Books ? Beaucoup d’acteurs se sont formés à l’outil Metope, grâce auquel plusieurs éditeurs peuvent publier en simultané à partir d’un même fichier source. Au-delà de l'aspect technique, souligne Marie Pellen, la confiance des éditeurs, des bibliothèques et de tous les partenaires d’Open Edition a été cruciale.
Aux côtés d'Open Edition, deux jeunes plateformes sont présentées aux professionnels de l'édition scientifique publique présents lors de ces Journées Médici. D'abord Peer Community In (PCI), plateforme fondée par Denis Bourguet, chercheur à Inra au Centre de biologie pour la gestion des populations, a fondé en 2017 . Cet outil propose un processus gratuit d’évaluation et de recommandation par les pairs d’articles scientifiques non publiés. « Le risque est en effet de voir l’open access prendre une évolution néfaste, celle d'une course à la publication ». L’objectif de PCI est de permettre aux chercheurs de se réapproprier le système de publication. L’idée : créer des communautés de chercheurs qui mettent en avant des preprints non publiés dans leur champ disciplinaires. Le système est gratuit pour les lecteurs et les auteurs.
Dans le même esprit de recherche d’une alternative aux grands éditeurs scientifiques privés, Nicolas Eberlé, fondateur de Publifactory, et Michael Rera, chercheur au CNRS à l’Institut de biologie Paris-Seine ont lancé PubliSciences fin 2018, une plateforme collaborative d’édition et de peer-reviewing d’articles. Avec un mot d'ordre : « Désubérisons la publication scientifique ensemble ! » Leur démarche part d’une indignation commune : celle de voir les scientifiques du monde entier transformés en « petite main-d’oeuvre » des grands éditeurs privés qui vendent très cher aux universités l’abonnement à des revues dans lesquelles, pour que les articles de leurs chercheurs soient diffusés, ces mêmes universités doivent payer des APC aux montants très élevés : environ 2 000 euros par article, avec des pics à 5 000 à 6 000 euros pour des publications telles que Nature. PubliSciences se présente comme une tentative de construire une alternative à ce modèle. La plateforme propose un outil d’édition adapté, les données sont facilement accessibles aux lecteurs et aux reviewers et tous les articles y sont en open access.
PubliSciences est une société coopérative d’intérêt collectif (SIC). « Les utilisateurs sont intégrés à la gouvernance pour éviter le rachat d’un acteur privé », explique Michael Rera. Pour les fondateurs de la plateforme, alors que les journaux et revues des éditeurs scientifiques privés trouvent leur valeur dans leur marque, la valeur d'une plateforme comme PubliSciences se situe dans la communauté qu'elle fédère. Comment est financé PubliSciences ? Le laboratoire du chercheur verse un montant allant de 500 à 700 euros par article. Sur cette somme, environ 100 euros sont dédiés aux frais de fonctionnement. L’excédent est redistribué dans la chaine d’édition et de reviewing. Les tutelles institutionnelles pour obtenir un financement plus récurrent ont aussi été sollicitées. Enfin, dans la SIC, les bénéfices générés sont exemptés de taxes et réintroduits dans la structure qui les produit.
C'est une initiative plus ancienne que décrit ensuite Bernard Pochet, directeur de l’Appui à la recherche et l’enseignement de l’Université de Liège. Celle de PoPuPS, plateforme ouverte dans l'université il y a quinze ans. « Les bibliothécaires de l’université ont souhaité proposer aux chercheurs des solutions simples et économiques », explique Bernard Pochet, « d’où l’utilisation du logiciel LODEL : tout le procédé éditorial était aux mains des éditeurs, nous proposions juste un outil de diffusion en ligne ». Progressivement, l’équipe responsable de la plateforme s’est fixée des objectifs de qualité des processus, de l’information fournie, des objectifs en matière de référencement, de conseil, de support.
Quels enseignements retire Bernard Pochet de cette initiative ? D’abord, si la majorité de articles qui y sont publiés sont des articles de revues de sciences, techniques et médecine (STM) - les SHS restant la « chasse gardée » de beaucoup de chercheurs de cette discipline - « PoPuPS a permis de maintenir des revues qui, sans elle, auraient disparues, d’en faire naître de nouvelles, de garder en archives des revues qui n’existent plus. » Ensuite, les objectifs de 2005 ont été dépassés : la plateforme publie aujourd’hui des revues extérieures à l’Université de Liège. Pour les éditeurs de l'université, PoPuPS est devenu un outil incontournable de diffusion. Reste un bémol, que Bernard Pochet reconnait volontiers : « nous manquons de temps pour réaliser certains développements, construire des formations à l’édition en ligne, rencontrer davantage les éditeurs. »
Cette rencontre, ce dialogue avec les éditeurs, Solenn Bihan, responsable de la valorisation sociétale à l’Université de Lille, explique combien ils ont été importants pour jeter les bases d’une pépinière de revues dans son établissement. « Les revues sont comme des plantes » estime-t-elle, « pour se développer, elles doivent prendre racine dans un environnement favorable ». Cultiver ce terrain propice relève parfois de la gageure : certains responsables de revue voient dans la science ouverte un « changement climatique, une évolution radicale à laquelle il faut s’adapter, faute de quoi elles meurent ».
En 2018, la fusion des universités lilloises suscite la mobilisation d’enseignants chercheurs en SHS : des discussions sont organisées à la demande de vice-présidente de l’université, associant tous les acteurs concernés, sans oublier les services financiers et informatiques. Y sont abordés les besoins des revues, la liste des services que l’université peut leur fournir. Les débats y sont parfois âpres, raconte Solenn Bihan : « pour certains enseignants-chercheurs, l’édition scientifique n’est pas forcément faite pour être lue ! ». A l’été, ces échanges débouchent sur un rapport, proposé comme base de la politique éditoriale de l’université, et voté à l’unanimité. Un système donnant-donnant : la revue s’engage à adopter des bonnes pratiques en matière de science ouverte, en échange de quoi l’université lui apporte, dans le cadre d’un engagement triennal, un soutien graduel, qui va du l’appui scientifique à l’aide à la diffusion papier ou numérique.
Qu'auront montré cet exemple et ceux présentés lors des 9e Journées du réseau Médici, au-delà de la variété et du foisonnement des initiatives en science ouverte ? Trois choses, peut-être. D'abord, que partout où la science ouverte avance, c'est au gré de collaborations étroites menées avec les professionnels de l'édition scientifique publique. Ensuite, que ces collaborations ne se décrètent pas d'en-haut, mais s'organisent au contraire selon des logiques horizontales, à partir de projets simples, qui répondent à des questions précises et concrètes. Enfin, que ces avancées ne se font qu'au prix d'un dialogue sincère avec toutes les catégories de professionnels concernés par la science ouverte.
Rien de neuf, de ce point de vue, sous le soleil. Dans le réseau Médici, que le dialogue soit source d'avancées et de collaborations fécondes, on le sait depuis longtemps.
Quelques liens :
- Le réseau Médici : http://medici.in2p3.fr/
- Le site des 9e Journées du réseau Médici : https://medici2019.sciencesconf.org/
- Le Plan S : https://www.coalition-s.org/
- PubliSciences : https://publiscience.com/
- Peer Community In : https://peercommunityin.org/
- Open Edition Books : https://books.openedition.org/